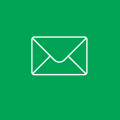Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont au cœur de l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité : handicap, perte d’autonomie, exclusion sociale. Avec près de 40 000 structures en France, ils incarnent un pilier essentiel du système de protection sociale. Mais comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs rôles, leurs missions et leurs obligations en matière d’évaluation et de qualité ? Découvrons ces établissements, leur cadre réglementaire, les enjeux de leur évaluation et les démarches mises en place pour qu’ils garantissent aux usagers un accompagnement optimal.
Comprendre les ESSMS : rôle, types et cadre réglementaire
Définition et mission des ESSMS
Les ESSMS sont des structures destinées à accueillir et à accompagner des personnes vulnérables via une large gamme de services allant de la prévention et du dépistage à l’accompagnement en institution ou en milieu ordinaire. Leur action s’inscrivant dans le champ social et médico-social, ils sont financés par l’Assurance Maladie, les collectivités locales et l’État.
Leur mission principale est de soutenir l’autonomie, l’intégration sociale et l’exercice de la citoyenneté des publics accompagnés : enfants, personnes en situation de handicap, individus âgés dépendants ou en difficulté sociale.
Les différents types d’ESSMS
Il existe une grande diversité d’ESSMS, chacun ayant sa spécialité et son public cible. Voici les principaux :
| Établissements pour personnes âgées | Ils accueillent des publics âgés en perte d’autonomie.
|
| Structures pour personnes en situation de handicap | Elles sont destinées à l’accompagnement des individus affectés d’un handicap, qu’il soit physique, mental ou psychique.
|
| Établissements et services de l’aide sociale à l’enfance | Ils accueillent essentiellement des enfants en difficulté ou en danger.
|
| Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) | Ils offrent un accompagnement aux individus en situation d’exclusion sociale (personnes sans domicile fixe ou en précarité extrême), avec pour mission de favoriser leur réinsertion. |
| Services d’aide et d’accompagnement à domicile | Ils proposent une assistance à domicile, permettant aux publics concernés de rester dans leur environnement, malgré leurs difficultés quotidiennes associées à l’âge, à la maladie ou au handicap.
|
Le cadre réglementaire
Le fonctionnement des ESSMS est strictement encadré. Ainsi, la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, régit leurs activités. Elle place l’usager au cœur du dispositif d’aide et d’accompagnement en affirmant ses droits et libertés. Elle impose également aux ESSMS de procéder à des évaluations régulières.
En outre, le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) précise les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement auxquelles doivent se conformer les ESSMS. Il encadre notamment les modalités d’autorisation, de contrôle et de tarification de ces établissements.
L’évaluation des ESSMS : enjeux et cadre actuel
Pourquoi évaluer les ESSMS ?
L’évaluation des ESSMS est une obligation légale, instaurée par la loi du 2 janvier 2002 précédemment citée et formalisée par l’article L312-8 du CASF. Elle vise à garantir la qualité des prestations et à impulser une dynamique d’amélioration continue, au profit des usagers. Ainsi, elle permet de vérifier que les établissements répondent aux besoins des bénéficiaires.
La démarche d’évaluation apportée par la HAS vise à :
- permettre au bénéficiaire d’être acteur de son parcours;
- renforcer la dynamique qualité au sein des ESSMS;
- promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESSMS et leurs professionnels.
Les résultats de chaque évaluation conditionnent le maintien ou le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement d’un ESSMS accordée par les autorités compétentes (Agence Départementale de santé, conseils départementaux).
Le référentiel HAS 2022, cadre de référence
Depuis 2022, la Haute Autorité de Santé (HAS) a apporté des modifications majeures au processus d’évaluation des ESSMS, avec la mise en place du référentiel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux destiné à tous les ESSMS du territoire.
Il est porté par quatre valeurs fondamentales
- le pouvoir d’agir de la personne ;
- le respect des droits fondamentaux ;
- l’approche inclusive des accompagnements ;
- la réflexion éthique des professionnels.
La durée du cycle d’évaluation a évolué et il est désormais de 5 ans. L’évaluation est obligatoire, effectuée par un organisme extérieur indépendant, autorisé à procéder aux évaluations et accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/IEC 17020. En outre, l’étape d’évaluation interne, auparavant obligatoire, a été supprimée. Elle reste toutefois recommandée et désormais nommée “auto-évaluation”.
Le référentiel comporte 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs déclinés en 157 critères d’évaluation, dont 139 standards et 18 impératifs. Il couvre l’ensemble des champs de l’accompagnement : promotion de l’autonomie, participation des personnes, prévention des risques, projet personnalisé… Pour chaque critère, il précise le niveau d’exigence attendu et les éléments de preuve à apporter.
Sa mise en application suppose une forte implication des équipes et une démarche projet structurée. L’enjeu est de passer d’une logique de conformité à une véritable dynamique d’amélioration continue, au service des usagers.
Enfin, les résultats de chaque évaluation sont transmis à la HAS puis publiés sur une plateforme dédiée, SYNAE, et affichés dans l’ESSMS concerné, afin de garantir la transparence auprès des usagers et de leurs familles.
Les étapes du processus d’évaluation
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes étapes du cycle d’évaluation prescrit par l’HAS.
| Étape | Acteur | Objectif | Fréquence |
| Auto-évaluation facultative | ESSMS | Faire un état des lieux, identifier les points forts et les axes d’amélioration, initier la démarche d’amélioration continue | Au minimum une fois sur 5 ans |
| Évaluation | Organisme autorisé et certifié | Porter un regard extérieur objectif, mesurer les écarts avec le référentiel | Tous les 5 ans |
| Transmission des résultats | ESSMS | Informer les autorités de contrôle et la HAS | Après chaque évaluation |
| Diffusion publique des résultats | ESSMS | Rendre compte aux usagers et au grand public | 4 mois après l’envoi des résultats à la HAS |
| Suivi des plans d’actions | ESSMS | Mettre en œuvre les améliorations identifiées | En continu |
L’implication des bénéficiaires
Enfin, le référentiel 2022, dans son premier chapitre, est directement centré sur la personne et son accompagnement et permet à partir du croisement des regards, d’apprécier la qualité des pratiques au quotidien. Elle s’appuie sur le recueil, avec son consentement, de l’expérience
de l’usager et de l’expression des professionnels qui l’accompagnent au quotidien.
La démarche qualité : outils et mise en œuvre
Les principes fondamentaux
Au-delà de l’évaluation quinquennale imposée par la HAS, les ESSMS sont encouragés à déployer une démarche qualité pérenne.
Celle-ci repose sur quelques principes clés :
- l’engagement de la direction, qui doit impulser la dynamique d’amélioration continue et piloter sa mise en œuvre effective ;
- l’implication des professionnels, chaque acteur jouant un rôle essentiel dans l’amélioration des pratiques ;
- la sollicitation des usagers et de leurs familles, dont la participation est primordiale pour adapter les services à leurs besoins et attentes ;
- l’amélioration continue.
Les outils de suivi et d’amélioration
Pour être efficace, une démarche qualité doit s’appuyer sur des outils de mise en œuvre (structurer les actions d’amélioration continue) et de mesures (estimation des progrès).
Il en existe un certain nombre, parmi lesquels :
- la plateforme SYNAE, déployée par la HAS et mise à disposition des ESSMS pour les aider à réaliser et à analyser leur autoévaluation ;
- les autoévaluations, réalisées en amont des évaluations, pour mieux anticiper d’éventuels ajustements ;
- les plans d’action, qui permettent de fixer des objectifs d’amélioration mesurables et de les suivre à court, moyen et long termes ;
- les indicateurs de qualité, pouvant autant concerner les droits des usagers (par exemple le taux de réalisation des projets personnalisés) que la gestion des RH (taux de turn-over ou taux d’absentéisme) ou la gestion des risques (nombre d’incidents, respect des protocoles d’hygiène), et permettant de « quantifier » les progrès et d’ajuster les actions en conséquence.
L’intégration de la démarche qualité dans le quotidien des ESSMS
Pour qu’elle porte ses fruits, la démarche qualité doit être envisagée non comme une contrainte, mais comme un levier d’amélioration des pratiques professionnelles et du bien-être des équipes et des usagers.
Pour ce faire, les ESSMS peuvent mettre en place un certain nombre d’actions :
- les groupes de travail thématiques, réunissant les professionnels autour de sujets clés ;
- la réalisation d’enquêtes de satisfaction, pour recueillir et analyser les retours des bénéficiaires et adapter les pratiques en conséquence ;
- l’élaboration de procédures claires, pour assurer que les pratiques des équipes sont homogènes et traçables.
En intégrant ces outils au quotidien, les ESSMS renforcent non seulement la qualité de l’accompagnement qu’ils proposent, mais aussi la motivation de leurs équipes et le bien-être des usagers.
Se former à l’évaluation des ESSMS : un enjeu stratégique
Pourquoi se former ?
La formation à l’évaluation des ESSMS est un enjeu stratégique pour les établissements. Elle permet en effet la conduite d’évaluations efficaces et pertinentes, conformes au cadre réglementaire, menées selon une méthodologie rigoureuse et suivies d’actions d’amélioration appropriées.
En outre, elle participe aussi à la professionnalisation des acteurs impliqués : directeurs, responsables qualité, professionnels de terrain et évaluateurs. En acquérant des pratiques d’évaluation structurées (méthodologie rigoureuse, outils adaptés, compréhension fluide du processus), ils prennent conscience de leur rôle et de leur impact sur la qualité de l’accompagnement.
In fine, la formation garantit aux usagers un suivi optimal.
Les formations d’Espace Sentein
L’évaluation des ESSMS est un levier essentiel pour garantir un accompagnement de qualité aux usagers et répondre aux exigences réglementaires.
Afin d’accompagner les professionnels dans cette démarche, Espace Sentein propose plusieurs formations spécialisées qui permettent de maîtriser les processus d’évaluation et d’amélioration continue.
Elles sont les suivantes :
Intervenant/e de l’Évaluation des ESSMS
Responsable Qualité – Évaluation du Secteur Social et Médico-Social
Référent/e Auto-Évaluation – Qualité des ESSMS
Ingénieur/e Certifié/e en Performance des Établissements Sociaux, Médico-Sociaux et de la Santé
Expert/e en Risques des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux
La formation, enjeu crucial face aux défis du secteur
La transformation numérique des ESSMS, les évolutions des pratiques sociales et médico-sociales, les réformes en cours et la nécessité d’une professionnalisation toujours plus grande des intervenants rendent la formation encore plus indispensable. En effet, les ESSMS doivent s’adapter aux nouvelles réalités du terrain.
L’émergence de l’e-santé et des outils numériques (dossier informatisé de l’usager, télémédecine, outils collaboratifs) impose un équilibre délicat : il s’agit pour les professionnels d’intégrer les avancées technologiques pour optimiser les services, tout en préservant les relations humaines, au cœur de l’accompagnement. La transformation numérique exige donc un pilotage stratégique, des investissements ciblés et un soutien aux équipes pour les accompagner dans le changement. Il est aussi crucial d’éviter la fracture numérique et d’expérimenter les meilleures pratiques digitales pour identifier les solutions les plus efficaces.
Par ailleurs, les ESSMS font face à un autre défi : s’inscrire pleinement dans les parcours de santé et de vie des usagers. Pour ce faire, ils doivent dépasser une logique strictement comptable et proposer des réponses plus souples, mieux coordonnées avec les autres acteurs du secteur. En développant des partenariats, en expérimentant de nouveaux modes d’accompagnement (plateformes de services, dispositifs passerelles) et en modifiant leurs pratiques professionnelles, ils peuvent jouer un rôle central dans la dynamique actuelle de décloisonnement et de coopération. Les réformes en cours, comme la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance ou le virage domiciliaire dans le champ de grand âge, s’inscrivent dans cette logique. L’offre de formation l’accompagne également.
Enfin, pour relever ces défis, les ESSMS doivent pouvoir compter sur des professionnels compétents et engagés. Le contexte de tension sur certains métiers impose une meilleure reconnaissance de leurs compétences, des perspectives d’évolution professionnelle attractives et des conditions de travail optimales.
Les ESSMS jouent un rôle clé dans l’accompagnement des publics vulnérables, en garantissant des services adaptés et de qualité. Encadrés par une réglementation exigeante, ils doivent s’engager dans une démarche d’amélioration continue, notamment à travers l’évaluation, devenue un levier stratégique d’optimisation des pratiques. Le référentiel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux HAS 2022 a contribué à modifier ce processus qualité : l’évaluation repose désormais sur une approche centrée sur l’usager, et implique une adaptation constante des ESSMS.
Pour répondre à ces exigences et assurer un accompagnement de qualité, la formation des professionnels du secteur est essentielle. Elle leur permet non seulement une meilleure maîtrise du cadre réglementaire, mais également une meilleure préparation aux enjeux à venir.
Découvrez notre formation certifiante pour devenir Intervenant(e) de l’Évaluation des ESSMS